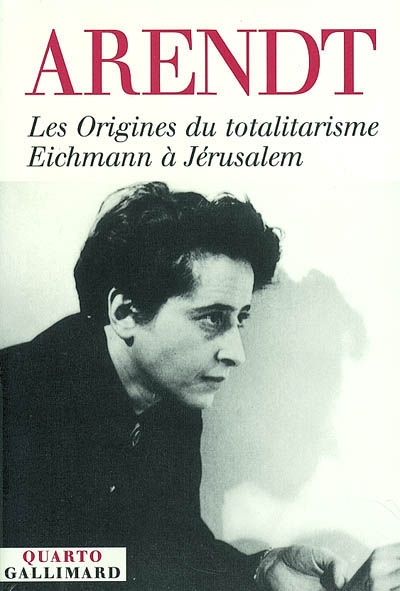
Les Origines du totalitarisme
1951 - Banque et assurance / Ce qui gène / Climat et évolution des hommes / Commerce / Commerce et distribution / Communication / Faire / Les États, puissance et influence / Les rapports aux autres / Les rapports aux produits / Les systèmes politiques / Les tendances lourdes / Les valeurs / Livre / Matière / Matières premières / Objets / Pouvoir / Religion et religiosité / Savoir/pensée / Se déplacer / Sentiments / Société & croyances / Vie / Violence internationale
Les Origines du totalitarisme a eu, dès sa parution en 1951, un retentissement mondial : c’est que cette œuvre, terriblement novatrice, proposait de comprendre comment la chose la plus impensable de l’histoire, les camps d’extermination nazis, avait pu arriver, en menant une réflexion sur la longue durée, en remontant l’histoire politique européenne et en utilisant les outils de la philosophie et de la sociologie. De plus, deux régimes étaient mis en parallèle, alors qu’ils apparaissaient à l’époque très différents : la Russie de Staline et l’Allemagne de Hitler… On imagine à quel point une telle comparaison fut décriée et son auteur voué aux gémonies, avant d’être considéré, quelques années après, comme une figure incontournable de la philosophie politique.
Hannah Arendt (1906-1975) avait de bonnes raisons de tenir à son projet : issue d’une famille juive allemande, elle avait étudié la philosophie avec les plus grands maîtres (Martin Heidegger, Edmund Husserl, Karl Jaspers), s’était intéressée à la pensée politique (Karl Marx, Léon Trotski et surtout Rosa Luxembourg), avant de fuir l’Allemagne nazie pour la France. Là, capturée et internée, elle avait réussi à s’échapper pour finalement gagner New York.
Pour elle, nazisme et stalinisme relèvent d’un même genre politique, le totalitarisme. Ce type de gouvernement ne vient pas d’une tradition nationaliste particulière : il est plutôt une sorte de conséquence logique du capitalisme d’État. Arendt montre comment l’antisémitisme, phénomène moderne distinct du vieil antijudaïsme, est né à la fin du xixe siècle, au moment où les Juifs riches perdent, dans les Etats européens, la part de pouvoir politique qu’ils avaient acquise tout en conservant une puissance financière (pour les mêmes raisons, à la Révolution française, le peuple a haï les nobles).
Or, à la montée de l’antisémitisme correspond la crise de l’Etat-nation et l’apparition des empires (français, anglais, russe, austro-hongrois), moment à partir duquel les bourgeois prennent le pouvoir politique et se lancent dans une logique d’expansion territoriale, pour accroître leur capital au mépris des droits de l’homme. La logique impérialiste aura des effets dévastateurs : crises économiques, guerres civiles, problèmes des minorités, essor du racisme. Ultime conséquence : les empires laissent de côté toute une masse d’individus « dégradés », ruinés ou aigris, devenus politiquement indifférents, qui seront séduits par la propagande totalitaire qui leur promet l’appartenance à un monde idéal.
Enfin, Arendt en vient à comprendre comment les régimes totalitaires ont mis en place un monde où « tout est possible », où règne la terreur et où les hommes sont devenus « superflus », précisant que de tels systèmes peuvent renaître « si nous nous obstinons à concevoir notre monde en termes utilitaires ». Depuis lors, plusieurs historiens et sociologues ont utilisé la notion de totalitarisme (ainsi Raymond Aron), mais celle-ci ne fait pas l’unanimité. Par ailleurs, il est toujours difficile de penser la comparaison entre l’Allemagne de Hitler et la Russie de Staline… Le débat n’est donc pas clos !